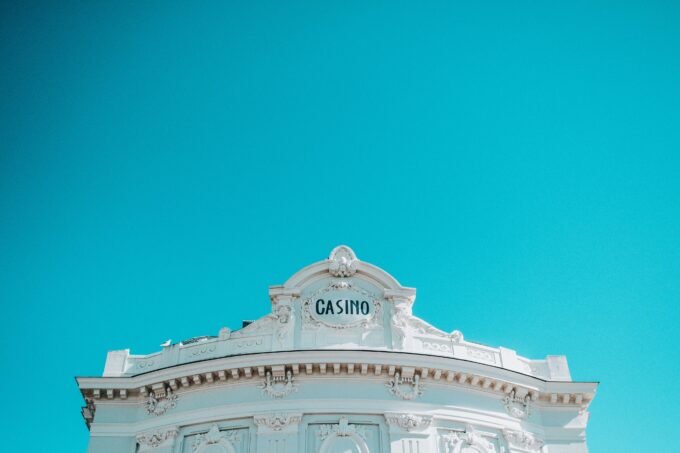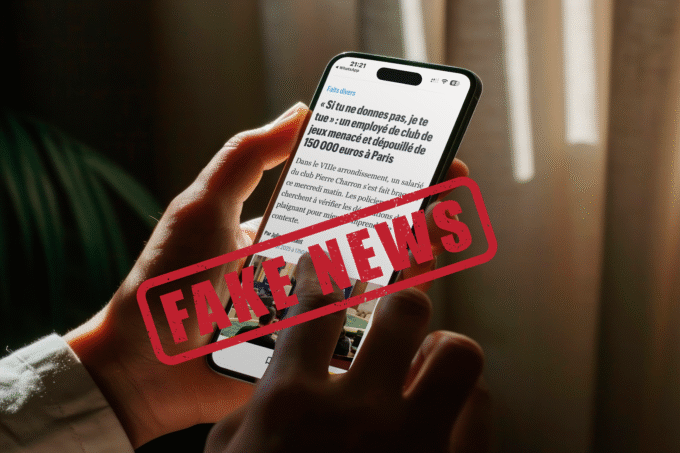Je n’ai pas pu m’empêcher de rire. Un rire jaune, certes, mais un rire tout de même. Car il faut un certain culot, pour qu’une banque, l’une des plus puissantes de France, ose se présenter en parangon de vertu en opposant la finance “responsable” au jeu d’argent.
Si l’investissement n’est pas un jeu d’argent, alors qu’est-ce que c’est ? Une messe ? Un serment moral ? Ou peut-être un tirage sans boules, où le hasard a simplement changé de costume et de vocabulaire ? Parce que, dans les faits, les marchés financiers sont tout sauf rationnels. Ils obéissent aux humeurs, aux rumeurs, aux algorithmes et à la peur ou même à une déclaration de Donald Trump, c’est dire ! Les traders appellent ça la volatilité. Moi, j’appelle ça le hasard.
Quand les banques jouent sans tapis vert
Le Crédit Agricole, justement, s’est récemment illustré dans l’affaire Cum Cum, ce petit jeu fiscal qui permettait à des investisseurs étrangers d’éviter de payer des impôts sur les dividendes français. Résultat : une amende de 88 millions d’euros, négociée discrètement avec la justice via une “convention judiciaire d’intérêt public”. Pas de procès, pas de coupable, juste une régularisation élégante.
Dans un casino, quand vous perdez, vous payez votre mise. Dans une banque, quand vous êtes pris la main dans le sac, vous payez… un arrangement. Et on continue à vous vendre des produits “responsables”.
Rappelons aussi que le monde bancaire a connu quelques “parties” mémorables :
-
2008, krach mondial provoqué par les subprimes : des prêts pourris titrisés, revendus, emballés dans du jargon jusqu’à l’explosion.
-
Le scandale du Libor, où plusieurs banques manipulaient les taux interbancaires.
-
La chute du fonds LTCM, en 1998, créé par des prix Nobel d’économie persuadés d’avoir dompté le hasard, avant de plonger dans le chaos.
Alors, qu’on nous explique où se niche la vertu. Car la finance, cette grande dame aux gants blancs, n’a jamais cessé de flirter avec le risque. Elle le rebaptise simplement par des mots plus « nobles » : Volatilité, gestion active ou effet de levier. Des mots que l’on pourrait concentrer en une phrase : on joue, mais avec votre argent.

Le jeu a ses règles, la banque a ses clauses
Dans le monde du jeu, les choses sont claires. Les probabilités sont affichées, les règles connues, l’avantage de la maison transparent. On ne vous promet pas de gagner, on vous promet un moment de chance. Et quand vous perdez, vous savez pourquoi.
Dans le monde bancaire, c’est une autre musique. Les conditions générales font parfois 30 pages, rédigées dans une langue que même Kafka trouverait obscure. Les frais de gestion, les commissions d’entrée, les produits “à risque modéré” qui dépendent d’indices incompréhensibles… Et si tout s’écroule ? “Les marchés ont été défavorables.” Autrement dit : la faute à pas de chance. Le hasard, encore lui.
La différence ? Dans le jeu, le joueur assume sa mise. Dans la finance, c’est souvent le contribuable qui paie l’addition quand tout s’effondre.
Les banques spéculent sur les produits dérivés, les États épongent les pertes. Les joueurs, eux, ne demandent pas de plan de sauvetage quand la roulette tourne mal.
Le double discours de la vertu
Derrière cette campagne publicitaire, il y a un discours moraliste :
Nous, banquiers, sommes les gardiens du bon risque.
Une manière subtile de discréditer le jeu, de rappeler au public qu’investir, c’est noble, alors que jouer, c’est frivole.
Mais dans un monde où les marchés déraillent au tweet près, où des algorithmes échangent des milliards en microsecondes, prétendre que l’investissement est rationnel relève du conte pour adultes.
Il n’y a pas de morale dans le hasard. Il n’y en a pas plus dans la spéculation. La seule différence, c’est que le joueur, lui, n’a jamais prétendu être vertueux.