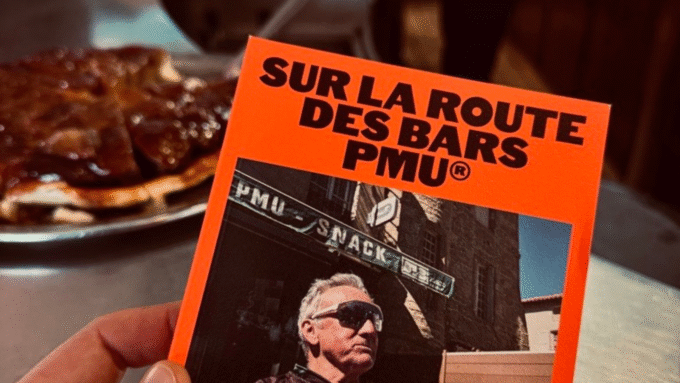Pendant plus d’une décennie, PokerStars fut bien plus qu’un opérateur. C’était une marque-monde, un symbole de mérite et d’ascension dans l’univers du jeu. Mais entre 2010 et 2020, cette marque-légende a connu une mue progressive : d’un modèle communautaire et passionné à une machine rationalisée et financière.
Ce basculement, amorcé avant le rachat par Amaya puis amplifié sous sa direction, marque la fin d’une époque : celle où PokerStars appartenait à ses joueurs.
2010–2012 : la télévision, fabrique de joueurs et vitrine culturelle
Au début des années 2010, PokerStars règne sur le poker mondial. Sur le .com comme en France, la marque s’impose non seulement par son produit, mais par sa présence médiatique.
Si Patrick Bruel a assuré la visibilité de Winamax au lancement du marché, PokerStars mise sur deux sportifs pour incarner l’image du “plus grand site de poker au monde”. Grimés en Napoléon, en boxeur ou encore en femme, Gael Monfils et Sébastien Chabal garantissent à la marque une forte présence médiatique et un capital sympathie créé par les spots de pub.
Cependant, contrairement à ses concurrents, elle ne se contente pas d’acheter des espaces publicitaires : elle produit ses propres formats, convaincue que la télévision peut transformer les curieux en joueurs.
Aux États-Unis, The PokerStars Big Game (Fox Network, 2010-2011) réunit pros et amateurs autour d’un cash-game filmé comme un talk-show.
Le concept du “Loose Cannon”, un joueur inconnu à qui PokerStars confie 100 000 $, incarne la promesse fondatrice : tout le monde peut défier les légendes.Coûteux à produire (environ 300 000 $ l’épisode) mais extrêmement rentable en notoriété, le format érige PokerStars en producteur du rêve poker.
En France, cette philosophie prend la forme de La Maison du Bluff (NRJ12, 2010-2016, disponible encore sur la chaîne DailyMotion de PokerStars), produit par Kawa Production. Mi-téléréalité, mi-compétition, l’émission met en scène des candidats qui s’affrontent et se forment auprès de coachs comme ElkY, Julien Brécard ou Yoh Viral.
Pour séduire au-delà du public poker, la production convoque des people : Greg le Millionnaire, Moundir, Philippe Candeloro ou encore Sébastien Chabal, tête d’affiche des campagnes de publicité de l’opérateur à l’ouverture du marché français. Ces invités dopent les audiences : 250 000 à 400 000 téléspectateurs parjour, jusqu’à 600 000 en prime, soit le double de la moyenne de NRJ12 pour la première saison.
Mais surtout, La Maison du Bluff agit comme un entonnoir d’acquisition : les castings passent par des freerolls PokerStars.fr, générant 40 000 à 70 000 nouveaux comptes par saison. Une machine à recruter, mais aussi une pépinière de talents : Pierre Calamusa et Romain Lewis, futurs Team Pro Winamax, y font leurs débuts. Ironie de l’histoire : PokerStars a “créé” des joueurs que ses rivaux récupéreront.

Des plateaux de Las Vegas à la villa de Marbella, PokerStars utilise la télévision pour construire un récit : celui d’une marque méritocratique où la passion mène au sommet. Entre The Big Game et La Maison du Bluff, le message reste le même : le poker est une histoire qu’on peut vivre.
Mais dès 2012, alors que les émissions continuent de recruter massivement, un autre mot d’ordre s’impose : la rentabilité.
2012–2014 : la mise en ordre avant la vente
À partir de 2012, le ton change. Les fondateurs, la famille Scheinberg, savent que la valorisation de PokerStars atteint des sommets. Le boom post-Moneymaker s’essouffle, les marchés européens se régulent, les États-Unis restent fermés. Rational Group veut vendre mais vendre haut. Le mot d’ordre devient dès lors : être break even.
Les investissements produits ralentissent. Les budgets se concentrent sur ce qui rapporte vite : les émissions télévisées, très rentables, et le marketing d’acquisition directe. En France, La Maison du Bluff perd un peu de son éclat, mais reste précieuse : PokerStars a racheté Kawa Production et doit rentabiliser cette filiale audiovisuelle.
Si l’investissement télévisuel est maintenu, les dépenses marketing commencent néanmoins à marquer le pas, la faute à l’émergence d’un nouveau marché pour la marque au pique rouge : l’Amérique Latine. Un marché en plein boom, bien plus rentable pour PokerStars qui fait le choix d’y consacrer plus de moyens qu’en France. Preuve de cet engouement, le brésilien Ronaldo rejoint la Team SportStars aux côtés de Rafael Nadal ou Boris Becker.

Sous la surface, la marque commence déjà à se transformer : moins d’innovation, plus de reporting, davantage de tableaux Excel. L’esprit communautaire cède doucement la place à la logique financière.
Quand Amaya Gaming surgira en 2014 avec son offre à 4,9 milliards de dollars, tout est prêt : la machine est belle, la rentabilité assurée, la culture en veille.
2014–2016 : l’ère Amaya, la rentabilité avant la culture
Le 24 juin 2014, Amaya Gaming Group annonce le rachat de Rational Group.
Les fondateurs quittent le navire ; la marque change d’âme. David Baazov, PDG d’Amaya, vise une opération financière : maximiser la valeur, réduire les coûts, diversifier les produits, puis revendre.
Dès 2015, les priorités sont claires :
- centraliser les équipes à Malte ;
- réduire les budgets locaux ;
- transférer l’argent du marketing vers le CRM ;
- maintenir la marge trimestrielle au-delà de 40 %.
La première victime de cette stratégie sera ce qui faisait la force de PokerStars jusque-là : la culture “poker-first” disparaît avec la prise en main d’Amaya.
Les équipes locales, comme celle de PokerStars France, sont priées de migrer à Malte. Si les différents bureaux européens se regroupent sur la petite île de Méditerranée, ce rapatriement entraînera des départs massifs et la perte d’un savoir local.
Sur le plan produit, le constat est brutal : le logiciel, autrefois un modèle d’ergonomie, n’évolue plus. Les budgets développement partent vers le casino, jugé plus rentable par le nouveau propriétaire.
Et vient 2016 : l’année de la rupture. Amaya annonce une hausse du rake et une réduction drastique du programme VIP. Les statuts Supernova et Supernova Elite, symboles d’une méritocratie interne, disparaissent.
Les joueurs réguliers crient à la trahison ; Daniel Negreanu tente d’éteindre l’incendie, Isaac Haxton claque la porte. La communauté ne parle plus avec PokerStars, mais contre elle.
Le cas français : une résistance symbolique
A l’image du village d’Astérix, la France résiste plus longtemps que les autres marchés. Depuis 2010, l’équipe locale entretient une relation de proximité avec les joueurs. Autour d’ElkY, Julien Brécard et de son acolyte Benjamin Bruneteaux, la filiale hexagonale incarne encore une voix communautaire et une vraie culture poker entretenue par chaque nouvelle saison de La Maison du Bluff.
Ceci dit, ce qui a permis à l’équipe française de PokerStars de maintenir son bureau parisien, ce sont ses résultats sur le marché. Entre 2011 et 2015, PokerStars France pèse plus de 30 % du marché, malgré la prédominance de Winamax. Cette réussite est notamment le résultat des innovations marketing portées par l’équipe basée à Paris.

Mais la directive d’Amaya tombe : tout doit être centralisé. Pendant 2 ans, les équipes françaises de PokerStars résistent mais en 2016, la direction française est rapatriée, les équipes dissoutes, la voix locale se tait amenant même le duo Benny et Yu à trouver refuge du côté de Betclic.
Ce départ marque plus qu’une restructuration : c’est la perte d’une culture.
Avant, on faisait du poker. Après, on vendait des produits.
Comme sur les autres marchés, les conséquences se font vite sentir : communications incohérentes, campagnes impersonnelles, chute du sentiment d’appartenance et chute des parts de marché.
Les campagnes deviennent standardisées, souvent traduites par Google Translate, décontextualisées, parfois truffées de fautes.
Le prestige du pique rouge s’étiole ; PokerStars n’écoute plus, elle optimise.
La tentation Winamax
Ironie du sort : en 2017, au moment où la marque perd son identité, certains dirigeants envisagent l’impensable : racheter Winamax. Rien d’officiel, mais des échanges exploratoires ont bien existé. L’idée : consolider la position française en absorbant le concurrent direct, devenu entre-temps une référence.
Un comble lorsqu’on sait que depuis l’ouverture du marché, PokerStars sous-estime Winamax : jugé “trop local”, le site parisien a construit un produit fluide, une expérience gamifiée, un ton connivent et une communauté fidèle. Tout ce que PokerStars a perdu, Winamax le cultive. Winamax a même réussi à inventer la dernière révolution en date du marché : les Expressos !
L’opération aurait été économiquement séduisante, mais culturellement impossible. Winamax incarne la liberté ; PokerStars, la bureaucratie. Et Winamax n’a jamais eu la moindre envie de vendre : la marque est rentable, indépendante, fière de son identité.
PokerStars voulait acheter ce qu’elle n’était plus capable de créer : une marque aimée.
2015–2018 : la diversification et la marginalisation du poker
Sous Amaya, la rentabilité devient la religion. Et à ce jeu, le poker n’est plus le produit roi ; c’est le casino qui prend le relais.
Le pari sportif : un lancement sans âme
En 2015, PokerStars lance BetStars. Le produit sort tard, sans ergonomie et très loin des standards du marché. L’ambition de la marque était de faire cross-seller ses joueurs de poker vers le pari sportif comme a su le faire Winamax en France.
Un échec commercial qui tient aussi bien au manque de légitimité de PokerStars sur le produit qu’au problème de lisibilité de l’offre portée par une nouvelle marque, BetStars, et à un produit tout simplement pas au niveau pour séduire les joueurs. Résultat : le sportsbook ne dépasse jamais 5 % du PBJ global de la société.
En France, le lancement passe quasi inaperçu ; Winamax et Betclic ont déjà gagné la bataille culturelle.

Le casino : la nouvelle poule aux œufs d’or
Le vrai coup de fouet vient du casino en ligne. En 2015, il représente 12,7 % des revenus du groupe ; trois ans plus tard 35,3 %, et devient rapidement majoritaire.
Le casino est plus rentable, plus simple à opérer, et ne demande ni communauté ni innovation produit.
Mais il a un coût symbolique : le poker devient le parent pauvre. Les innovations se raréfient ; la plateforme vieillit. Le “laboratoire poker” de Rational devient une division à bas coût. La vision long terme d’Isai Scheinberg laisse place à la logique de rendement : acheter, exploiter, revendre.
Cette stratégie fonctionne comptablement ; mais elle détruit le lien culturel. Le joueur n’est plus un partenaire, c’est un segment CRM.
2019–2020 : GGPoker, le miroir inversé
Alors que PokerStars s’enlise dans la bureaucratie, un nouvel acteur surgit : GGPoker. Né en Asie, le réseau comprend ce que la génération Twitch attend :
- une interface fluide et ludique,
- des tournois gamifiés,
- des ambassadeurs streamers souvent anciennement sponsorisés par PokerStars (Daniel Negreanu, ElkY, etc.)
- un ton communautaire décomplexé.
En l’espace de 2-3 ans, GGPoker devient le refuge des grinders. Il accueille la licence WSOP Online dès 2020, symbole d’une bascule historique. Les pros migrent, le trafic explose, la marque devient cool. Pour la première fois, PokerStars n’est plus la référence technologique : elle devient l’institution dépassée. Tout comme pour Winamax, PokerStars n’a pas prêté attention à la proposition de valeur apportée par GGPoker, répliquant sur le .com la suffisance qui lui a coûté cher en France face à Winamax. Même si les WCOOP restent dans le calendrier des meilleurs grinders mondiaux, les story Instagram, stream Twitch et autres publications se font désormais autour de GGPoker. Le centre de gravité a changé de maître.

La fin de l’époque Amaya
Lorsque GGPoker s’impose sur la scène internationale, un autre événement, plus discret mais tout aussi symbolique, scelle la fin d’un cycle : PokerStars change de main.
En mai 2020, la room quitte définitivement le giron d’Amaya, devenu entre-temps The Stars Group, pour rejoindre Flutter Entertainment, maison-mère de Paddy Power, Betfair et FanDuel.
Cette opération, d’un montant d’environ six milliards de dollars, met un terme à six années de gestion financière, de recentrage et de désenchantement. Pour Amaya, l’objectif était atteint : acheter, rentabiliser, revendre plus cher. Pour PokerStars, c’est la fin d’une époque : celle où la marque, jadis motrice d’une culture, s’est transformée en actif de portefeuille.
Le passage chez Flutter ouvre un nouveau chapitre, celui d’un groupe qui ambitionne de créer un géant mondial du jeu équilibré entre casino, paris et poker.
Mais à ce stade de l’histoire, une page se tourne : le pique rouge n’est plus l’emblème d’une communauté, mais la pièce d’un ensemble globalisé.